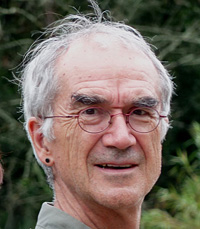Au Vent des Iles – 2007

1
Mon cheval fume dans la pénombre jetée des plus hautes branches. L’air est humide, la terre couverte de feuilles détrempées et pourrissantes. Les troncs des châtaigniers et des chênes, tiges lisses ou craquelées, forment barrière de toute part, se referment derrière moi comme si je n’étais pas venue par un chemin et, devant, obstruent vite un passage cru possible. Un sentier existe pourtant, une horizontale aberrante dans ce hérissement issu de la terre et barrant le ciel, qui voudrait unir terre et ciel mais exclut l’un et l’autre.
Les sabots de mon cheval s’enfoncent dans les feuilles gorgées d’eau et qui ne craquent plus. Je n’ai pas froid, je suis bien, me sens en harmonie. J’ai jeté mon casque en métal dans un creux de broussailles. À moins que je ne m’en sois pas coiffée ce matin en partant ? Depuis plusieurs heures maintenant je parcours campagnes et bosquets, longe l’orée des bois et m’y enfonce parfois, afin d’éprouver régulièrement l’utile sentiment de crainte qui me rend plus attentive lorsque je dois quitter l’abri des arbres.
Un air plus frais, plus mobile, se pose sur mon visage et mes mains, un air parfumé par les pins dressés à la lisière du bois. Le cheval s’arrête, il a compris quand j’ai relâché les rênes. Il étire l’encolure et, là où les aiguilles ne forment pas de nappes sèches et lustrées, il fouine des naseaux dans quelques touffes de bruyère poussant entre les rochers.
Devant moi, une longue pente dépourvue d’arbres se termine par une bande broussailleuse sous laquelle coule certainement un ruisseau. Au-delà, la nappe de terre ocre clair, soigneusement sillonnée par l’homme sur ce flanc, remonte, puis forme une succession de bosses, certaines boisées. Plus loin encore, là où la terre forme une ligne noire au pied du ciel immense parcouru de lourds nuages bas, montent des fumées. Une sur ma gauche, deux vers la droite, la première s’effilochant dans ce qui doit être le tourbillon de vent alentour de l’averse dont je vois les stries sombres. Je relève mon col racorni, me hausse sur mes étriers et resserre les pans de mon manteau de cuir sur mes cuisses. Ce vêtement n’est pas celui que je porte d’ordinaire, pourtant je l’ai enfilé ce matin à l’aube, ainsi que le bonnet de cuir aux oreillettes en fourrure, pour ressembler à ceux que je suis chargée d’espionner. Mais où sont-ils ? Les fumées, dont l’une se renforce en volutes noires et les deux autres s’estompent, attestent de leur passage mais ne renseignent en rien sur leur présence. Ils vont si vite sur leurs chevaux, et se comportent comme l’averse, déjà fondue dans les rouleaux blancs qui coiffent la colline sur ma droite. D’ici, je n’entends aucun bruit sinon celui des branches qu’agite parfois le vent et le clapotis des gouttes qui s’en détachent, bien différent du crépitement que faisait la pluie tout à l’heure. Pourtant, dès que je cesse de détailler ces ondulations, ce ciel, ces arbres, ces bruits, je sais où sont les hommes que je cherche, car je sens où ils s’installent. Je le sens dans ma tête, mes épaules, mes seins et au frémissement dans mon ventre. Je m’approche d’eux, je passe progressivement dans leur camp, je deviens comme eux. Sauvage, animale.
Un souffle de vent, malgré de multiples détours et ressauts, arrive toujours là où il le doit. Je retrouverai ceux vers qui tout me porte. Les autres, ces gens qui m’ont envoyée et que déjà j’oublie, ont commis une erreur : ils m’ont choisie parce que depuis toujours je connais les chevaux, les forêts et les langues étranges. C’est vrai, de la sève de hêtre coule dans mes veines, je sais distinguer crissement de patte d’écureuil et écorce qui bat au vent, les chevaux m’écoutent, je parle turc et mongol. Mais quelle erreur ! Il ne fallait pas me demander d’enfiler ce manteau de cuir, de monter sur ce cheval capturé, me donner ces armes d’homme. L’odeur de vieille peau unie à celle de mon corps m’enivre. Mon ventre et mes cuisses ne font plus qu’un avec le cheval. Mes yeux se plissent, se brident. Sur le dessus de mes bras la peau n’a même plus un duvet. Je ne tends pas les rênes, ne pique pas des talons, ne dis rien, mais je pense départ, et mon petit cheval brun trotte maintenant en longeant le bois. J’ai laissé par terre mon épée et mes fibules romaines, jeté les étriers et, courbée sur l’encolure, les pieds arqués dans les sangles de cuir qui se tendent contre l’intérieur de mes cuisses, c’est maintenant du bout d’un javelot au manche de bois grossier que j’écarte les quelques branches basses qui gênent mon passage. D’ici une heure ou deux je verrai le camp des Huns. J’ai beaucoup à leur dire sur les portes et les défenses de la ville. Je ne reviendrai pas raconter le nombre des chariots, l’importance de la horde.
2
C’est la raison pour laquelle, dès que possible, j’ai quitté les lieux pour aller fréquenter les lodges à surfeurs et, le lendemain, ai décidé de passer une journée entière avec un vieil homme, Mr Wilson, qui propose des visites guidées de la jungle. Avec lui, j’ai accompli un très beau parcours, une longue marche sur la plage avant d’arriver à des rochers et d’entamer là une ascension dans les collines, de redescendre dans les creux et de remonter encore. Tout cela en suivant des sentes infimes que Mr Wilson est seul à connaître et qui permettent de surprendre des oiseaux, des insectes aux couleurs rutilantes, de petits lézards d’un vert translucide en attente sur les termitières collées en hauteur sur des troncs, et de gros lézards bruns peu disposés à quitter un fruit trop mûr explosé à terre. L’homme aux jambes arquées comme des boomerangs s’avançait nonchalamment dans la jungle et m’a fait remarquer, dans le foisonnement à première vue uniforme, une véritable épicerie : des végétaux dont les noix ou les feuilles ou les tiges sont comestibles, d’autres dont la feuille permet la confection d’objets, de cordes, de revêtements des murs, de peintures corporelles de cérémonie. Une pharmacie aussi : avec des lianes dont les tronçons macérés fournissent un remède à divers maux, des plantes dont le contact irrite ou brûle, dont les sèves rendent aveugles, font tousser ou courir pour s’accroupir derrière un arbre où l’on a besoin d’autres feuilles encore, veloutées celles-ci. Les branches abritent des nids de larves comestibles, des plantes épiphytes aux formes étranges allant de la lanière à la dentelle, des écoulements d’humeurs sur lesquels viennent s’enivrer les scarabées…
J’adore la botanique ici. Elle commence par une division radicale des milieux en plant blong solwata et plant blong bous — végétaux du littoral salé et végétaux du bush de l’intérieur. Les genres, ensuite, sont faciles à retenir : kenutri, glutri, kandeltri… arbre à tailler des canots, arbre à colle, arbre à cire pour faire des chandelles. Bref, j’ai eu droit à un régal naturaliste en compagnie de Mr Wilson, soixante-treize ans mais agile comme un lézard, coastwatcher durant la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire éclaireur pour les troupes débarquées ici en milieu inconnu et hostile, et de ce fait médaillé pour sa bravoure et ses actions derrière les lignes ennemies, à l’âge où d’autres étaient encore dans les jupes de leur mère. Le vieux s’enorgueillit aussi d’avoir été de ceux qui secoururent le futur président Kennedy, réfugié sur un îlot des environs, après que sa vedette avait été coulée par un bateau japonais. Mr Wilson a même su répondre à ma question sur ce que pouvait être le «bois tabou» avec lequel les enfants avaient construit le piège bloquant le requin femelle de la légende de l’îlot de Buzu. Selon lui, bien qu’il ne soit pas originaire de la même île, il doit s’agir du fisposentri dont le jus — comme l’indique le nom de l’arbre — répandu dans l’eau permet de ramasser les poissons ventre en l’air, et pourrait être en mesure d’assommer un requin.
Quoi qu’il en soit, au retour de la journée découverte — l’idée avait germé et poussé dans ma tête comme une plante de la jungle luxuriante — j’ai présenté mon encyclopédie locale à Denis. Une fois n’est pas coutume, j’ai imposé mon grain de sel dans l’organisation. C’est maintenant réglé : Mr Wilson nous accompagnera dans notre visite de Kolombangara et l’ascension qui s’impose à moi comme nécessaire, et ce d’autant plus que tous ceux à qui je demande des renseignements sur l’île désirée ne répondent que «Mi no sabe misis», ignorance stimulante pour l’exploratrice que je veux être — ne fût-ce qu’à hauteur des chevilles de Frédéric —, moi qui, si ma fille était présente, pourvu que ce soit à la fois physiquement et mentalement, aimerais la serrer très fort contre moi et l’appeler «mon arbre à pain» et «ma fourmi des antipodes».