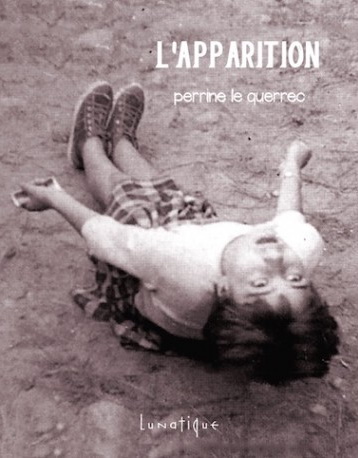Réminiscences désolées, et maladroit hommage, du poisson libre dans (son) creux d’eau oublié
par Marie Bronsard (29 mai – 1er juin)

Dans mes archives, ce petit texte : « Les septentrions légendaires de Jean-Claude Pirotte » que l’on m’avait demandé au Temps qu’il fait pour un numéro spécial de revue à lui consacré. Je l’avais commis, non sans m’en étonner. L’aventure, le connaissant, paraissait hasardeuse. Je n’avais pas tardé à être renseignée. Et d’un : de mon vivant, jamais. Et de deux : tu peux écrire ce que tu veux, je m’en fous. Le message était clair. Il n’a, en effet, jamais cherché à savoir ce qu’il en était.
Le texte est daté, septembre 2002-mars 2003. Six mois pour cinq pages. Et onze ans, déjà.
Il y a onze ans, nous avions commencé à nous perdre de vue. Loin des yeux, certes, néanmoins toujours près du cœur. À la moindre occasion de retrouvailles, physiques, auditives – fort rares, il ne goûtait guère le téléphone –, ou de lecture, immédiatement, le temps, les distances s’abolissaient.
C’est que nous avions été l’objet, au printemps 1983, d’un réel coup de foudre amical. Une quasi semaine à parler, boire – bien sûr – , nous baguenauder dans Paris, la nuit, faire escale dans des rades de plus en plus glauques – mais sous son aile protectrice, bien qu’un tantinet titubante avant l’aube, adoubée petite sœur en écriture, je n’avais pas à craindre les importuns –, parler encore, invoquer, plus qu’évoquer, Dhôtel, Calet, et tutti quanti, dormir quelques heures chez ses hôtes qui, se méprenant, m’avaient, dès leur retour, mise à la porte, donc il avait suivi : il nous restait beaucoup à nous dire – nous n’en avons jamais fini. J’avoue ne plus avoir qu’un souvenir nébuleux de la fin du périple, de sa durée, ni de ses modalités.
À peine avions-nous retrouvé nos pénates respectives, languedociennes en ce qui me concerne, au gros buisson, lui, dans le faubourg de Namur, que s’était inaugurée une correspondance assidue, quotidienne ou presque. Laquelle s’est lentement distendue lorsqu’il a quitté la Belgique pour s’installer en France – comme Jean-Claude s’installait, toujours sur une patte, entre deux voyages, deux virées dans les provinces, voire deux guindailles –, à l’hôtel Elise, rue Goethe, de Strasbourg, à Lorient, dont l’adresse ne me revient plus – une strophe, un paragraphe succinct doivent en avoir gardé la trace –, où il s’en était cassé une, de patte, après quoi il avait adopté une canne de dandy pour pallier une démarche incertaine, que, ne prêtant qu’aux riches, d’aucuns malintentionnés avaient attribuée à son intimité – plus qu’à sa science, peu s’en faut exhaustive, sinon exclusive – des nectars de la vigne. Plus tard, la rue des Remberges à Angoulême, Auriac…
Je lui rendais visite une ou deux fois l’an, le rejoignais parfois à Paris où, bien qu’accompagné, il appréciait, en certains circonstances littérairo-mondaines, de m’avoir à ses côtés, pour mieux se gausser. Il lui est arrivé de s’arrêter chez nous, au retour d’une incursion dans les Méridiens haïs. Sur ce sujet, nous ne pouvions tomber d’accord : il disait pis que pendre de l’Italie, et n’avait pas de mot pour fustiger la morgue, la pouillerie des Ibères – il insultait mes aïeuls ! ma lignée ! je regimbais –, du moins jusqu’à ce qu’il ait hissé Barcelone au panthéon de ses terres légendaires.
Curieusement, c’est au détour des années deux mille, lorsqu’il semblait avoir posé durablement son sac dans les vignobles du Cabardès – il s’était même décidé à y créer et animer une collection, chose impensable en d’autres temps –, en notre, dès lors, commun Languedoc, que nos rencontres se sont espacées.
Lire la suite…