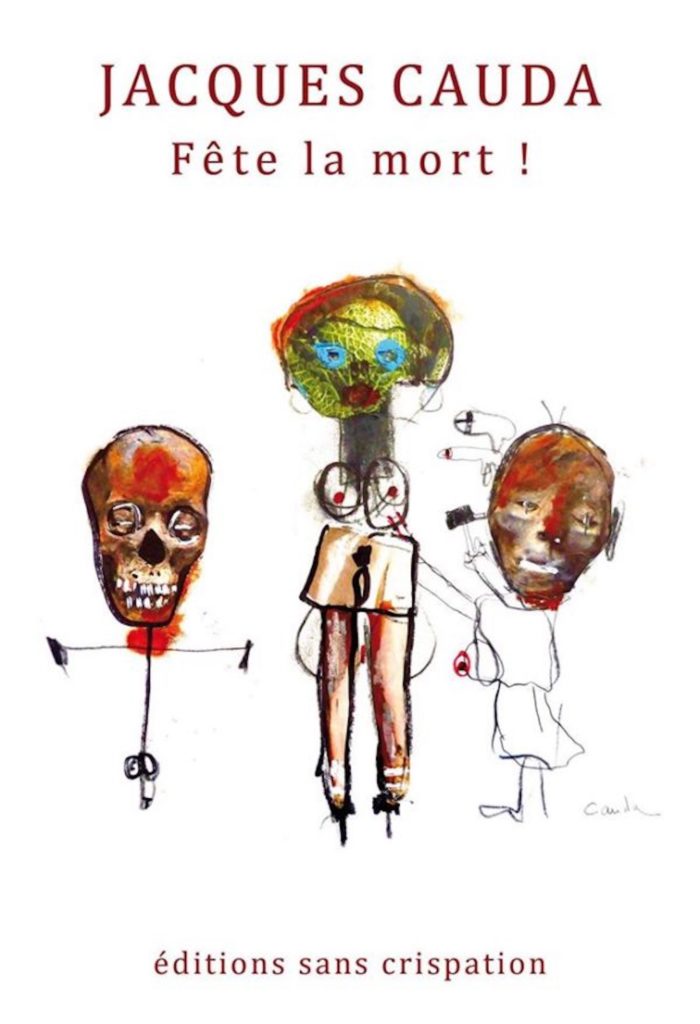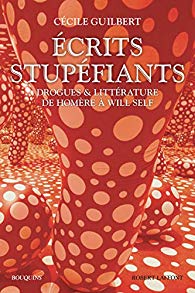On s’en rendra compte probablement plus tard, il est l’écrivain français le plus important de la période. Il propose une vision du monde complète et homogène, sans rien laisser de côté, en rassemblant et harmonisant des univers aussi vastes et divers que la Chine, la Grèce, le 18ᵉ, la peinture, la poésie, la musique, la religion catholique, la sexualité ou la politique. Toujours sous forme d’ouverture, il offre à lire ou regarder, notamment grâce à un sens consommé de la citation, nombre d’écrivains, penseurs et artistes : « Il n’y a qu’une seule expérience fondamentale à travers le Temps. Formes différentes, noms différents, mais une même chose. Et c’est là, précisément le roman. » Audace de pensée, originalité, esprit critique, sens de la formule, de l’esquive et de l’attaque. Avec lui, la poésie n’est pas séparée de la pensée, ni de l’action. Il ajoute, provoquant : « La poésie, c’est la guerre. » S’inspirant de Sun Tzu : « Si vous connaissez vos ennemis et que vous vous connaissez vous-même, mille batailles ne pourront venir à bout de vous. » Sa stratégie est clairement posée : « Ce que l’ennemi attaque, je le défends, ce qu’il défend je l’attaque. » Le difficile bien sûr est de connaître l’ennemi. Il le décrit dans Éloge de l’Infini : « Car l’Adversaire est inquiet. Ses réseaux de renseignement sont mauvais, sa police débordée, ses agents corrompus, ses amis peu sûrs, ses espions souvent retournés, ses femmes infidèles, sa toute-puissance ébranlée par la première guérilla venue. Il dépense des sommes considérables en contrôle, parle sans cesse en termes de calendrier ou d’images, achète tout, investit tout, vend tout, perd tout. Le temps lui file entre les doigts, l’espace est pour lui de moins en moins un refuge. Les mots « siècle » ou « millénaire » perdent leur sens dans sa propagande. Il voudrait bien avoir pour lui cinq ou dix ans, l’Adversaire, alors qu’il ne voit pas plus loin que le mois suivant. On pourrait dire ici, comme dans la Chine des Royaumes combattants, que « même les comédiens de Ts’in servent d’observateurs à Houei Ngan ». Le Maître est énorme et nu, sa carapace est sensible au plus petit coup d’épingle, c’est un Goliath à la merci du moindre frondeur, un Cyclope qui ne sait toujours pas qui s’appelle Personne, un Big Brother dont les caméras n’enregistrent que ses propres fantasmes, un Pavlov dont le chien n’obéit qu’une fois sur deux. Lire la suite…
Catégorie : chroniques
Histoire de la propriété intellectuelle, de Gabriel Galvez-Behar, une chronique d’Anne-Marie Jeanjean
Histoire de la propriété intellectuelle de Gabriel Galvez-Behar*, Ed. La Découverte, août 2022
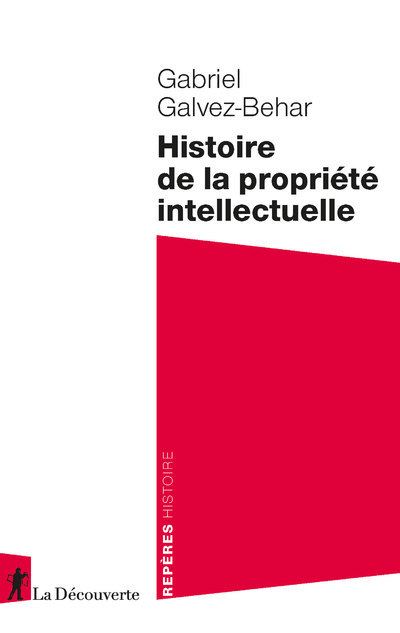
L’expression « propriété intellectuelle » m’a longtemps semblé bizarre, aussi ce petit livre proposant une vue très synthétique de la question à travers pays et siècles n’a pas manqué d’attirer mon attention.
***
Pour ce qui est de l’Antiquité, en Grèce, si l’origine de l’inspiration est divine, il semble que depuis Hérodote, les auteurs dans de nombreux domaines signent leurs œuvres. En Égypte, un plagiaire de textes fut confondu et puni. Quant à Rome, la volonté de contrôle de la qualité des œuvres intellectuelles par les auteurs était bien réelle.
Au Moyen-Âge : « Le savoir est un don de Dieu et ne peut donc être vendu. »
Il va exister rapidement des tensions entre la gratuité et les besoins de ceux qui œuvrent pour la diffusion des textes bibliques avec de petits arrangements plus prosaïques. Enfin, Thomas d’Aquin donne le « la » et à partir du 12e siècle le travail intellectuel justifie plus ouvertement le salariat, l’économie du livre augmentant rapidement.
Il faut aussi noter que très tôt le savoir-faire des artisans en chacun de leur domaine fut protégé, contrôlé par les confréries, les compagnonnages, et autres corporations (verriers de Venise, métiers de la soie à Paris, etc.).
Techniques et commerce, par leur dynamique, amènent les différents pouvoirs à limiter les autorisations par l’instauration des privilèges (accordés par le roi), par l’Imprimatur pour l’église (Léon X – 1515) et le dépôt obligatoire à la Librairie Royale, etc. D’autre part, les rivalités entre corporations ou à l’intérieur d’un même métier (communauté des imprimeurs et libraires de Paris aux privilèges contestés par les libraires de Lyon et Rouen, par ex.) et l’émergence des marques influent sur les modifications des lois. Lire la suite…
Fête la mort !, échos de lecture de Jean Azarel
Jean Azarel a lu Fête la mort, un livre de Jacques Cauda (éditions Sans crispation, 2020)
Fête la mort, ou Faîtes la mort, y compris l’amour et la guerre, pourrait-on dire pour parler du huitième roman du « peintrécrivain » Jacques Cauda, initiateur du courant pictural « surfiguratif ».
Lorsqu’on fait un portrait, et à fortiori le sien propre, il y a trois manières de poser un visage : ou de face, ou de trois quarts, ou de profil. De face, le portrait regarde son semblable, c’est-à-dire la mort droit dans les yeux. De trois quarts, il regarde Dieu, l’éternité, l’infini. Et de profil, sa postérité, comme Erasme peint par Holbein regarde son acte d’écrire. Quand en 1800, Goya peint son Autoportrait, il regardait déjà sa propre mort droit dans les yeux. Il était déjà trop tard.
Pas très réjouissant me direz-vous ? Certes, mais pas d’amalgame. En une dizaine de saynètes où l’horrible s’adoucit de jubilatoire et de poésie, Cauda nous conte des histoires à dormir debout et étreindre itou, où la réalité copule avec l’imaginaire pour nous rappeler que mourir peut être un art de vivre, si le destin n’en décidait pas trop souvent autrement.
Où donc, il est question des aventures du trio composé de l’auteur et ses acolytes foutraques Petit Muscle et Saucisson, du rapport entre le ressouvenir en avant de Kierkegaard avec le jeu de rugby (ses mêlées et ses démêlés), de la Crevette et de Rintintin, d’une lettre à Lou sur un air de Chet Baker, en passant par une cochonne répondant au doux nom de Mèrepute, via un détour très spécial au pays des merveilles de Juliette, pour s’encroumer in fine dans la mornitude professorale d’une certaine et incertaine madame L…. Lire la suite…
Liberté, film d’Albert Serra, une chronique cinéma de Jean Azarel
Critique cinéma : Liberté, d’Albert Serra, octobre 2019
 À l’accueil, le directeur du cinéma à qui je dis que je vais voir LIBERTÉ me répond « bon courage », puis devant mon étonnement : « depuis que je suis là, c’est un des rares films où je vois autant de personnes sortir avant la fin ».
À l’accueil, le directeur du cinéma à qui je dis que je vais voir LIBERTÉ me répond « bon courage », puis devant mon étonnement : « depuis que je suis là, c’est un des rares films où je vois autant de personnes sortir avant la fin ».
Nous étions 6 sur les fauteuils au départ, nous arrivâmes 5, et j’ai tenu ! Certes le rythme est lent, la chair plus âpre que joyeuse, voire triste, les comédiens physiquement hétéroclites (si les hommes font peu envie, à l’image d’un Helmut Berger prodigieusement sénile, le réalisateur ne se prive pas de mettre en scène des jolies femmes), et le film pourrait aisément être raccourci de vingt bonnes minutes.
Mais l’essentiel n’est pas là. Adepte des films en costume, Albert Serra nous conte la vie (?) d’un groupuscule de libertins chassés de la cour de France au XVIIIe siècle, et trouvant refuge dans une forêt prussienne pour poursuivre ses pratiques. Sexes masculins fatigués, jouissances mécaniques, actes sado-maso, saillies scatologiques, sévices divers, se succèdent dans des clairs obscurs savamment étudiés et une gestuelle minimaliste qui n’est pas sans rappeler le théâtre no. On passe d’un tableau à l’autre, en plein air, ou dans des chaises à porteurs (une trouvaille du film) ; Serra fait indubitablement œuvre de peinture, soignant remarquablement la forme. Lire la suite…
Chronique littéraire : Écrits stupéfiants de Cécile Guibert, par Jean Azarel
Écrits stupéfiants, de Cécile GUILBERT
collection Bouquins, Robert Laffont éditeur, septembre 2019
Nous avons pour la plupart la volonté de ne pas mourir idiots. Chacun a sa ou ses recettes. Lorsqu’elles sont communes, elles rassemblent les hommes et les femmes, surtout lorsque leurs variantes permettent d’augmenter la qualité des échanges, quand l’immuable conduit au principe moutonnier qui plaît tant à nos gouvernants et aux multinationales.
Avec Écrits stupéfiants, l’essayiste et romancière Cécile Guilbert nous donne (ou presque, pour la modique somme de 32 € qui n’est rien au regard des 1440 pages de ce pavé de mots délicatement feuilleté) à lire la somme d’un travail de près de dix ans d’une richesse phénoménale. Après un prologue personnel d’une sincérité de haut vol où l’auteure livre sa vérité sur le sujet (vérité que je fais mienne), place à une incroyable (mais vraie) revue des drogues (terme générique) de toutes natures et de leur rapport à la littérature, à travers toutes les époques, d’Homère à Will Self comme l’indique la première de couverture.
Après un second prologue dédié à deux substances mythiques le soma et le népenthès, Écrits stupéfiants s’architecture en quatre parties. Lire la suite…
Sula de Toni Morrison, par Valéry Meynadier
De l’écriture gospel

Ce livre est un autodafé. Sous le signe du feu et de la prière. Eva brûle son fils Plum car il est sous l’emprise de la drogue. Hannah la fille d’Eva brûle par accident sous les yeux de sa fille Sula qui « avait regardé sa mère brûler non parce qu’elle était paralysée mais parce qu’elle trouvait ça intéressant ».
Années vingt. Tout se passe dans Le Fond, une terre aride en haut des collines donnée par un blanc à un esclave au cœur d’une Amérique émergeante.
Sula se lie d’amitié avec Nel, elles ont le même âge, elles découvrent tout ensemble : le printemps, les garçons. « Chacune trouva refuge dans la compagnie de l’autre. Elles purent alors ignorer les façons de faire des autres et se concentrer sur leur propre perception des autres. » Quand Nel se marie, Sula va à Nashville, à Détroit, à la Nouvelle-Orléans. Dix ans passent à voyager ainsi de ville en ville quand Sula revient, marquée d’une inquiétante étrangeté dans « un mois de mai comme lustré, avec un miroitement vert … », elle couche avec le mari de Nel.
Toni Morrison, seule femme noire à avoir reçu à ce jour le prix Nobel de littérature (en 1993), est née dans l’Ohio en 1931. De culture africaine et afro-américaine, elle chante la cause noire, la négritude, les Noirs américains et les Noirs africains qui, dans son œuvre, sont tous occupés à scier la branche sur laquelle ils sont assis, branche qui appartient au passé, par conséquent à l’esclavage. Comment devenir libre après avoir vécu ce qu’ont vécu leurs ancêtres ?
« Sula n’avait pas d’ego. Et donc aucun besoin de se vérifier elle-même – d’avoir la moindre cohérence ».
L’ego d’un peuple entier a été tué, voici ce que dit ce livre. Sula est une prière crachée à la face de Dieu au rythme d’une écriture gospel, poétique, enragée, engagée. Dans l’ombre de Toni Morrison se tient la grande morte Nina Simone. Elles chantent en chœur la mimèsis, clament l’énergie vitale de la vérité, à nous d’entendre.
Au livre, les mots de la fin : « C’était un beau cri – long et fort – mais il n’avait pas de fond ni de hauteur, que les cercles sans fin de la douleur. »Ils sont aussi les derniers mots de Sula.

Paru en 1973, traduction française de Pierre Alien, chez Christian Bourgois, 1992 – 10/18, domaine étranger, 1993
Article publié dans le numéro 26 de notre magazine FUNAMBULE, fév 2013
Oobèse, de Jacques Cauda, une chronique littéraire de Jean Azarel
Oobèse, roman, Z4 Éditions, 2019
Si Oobèse est une farce savamment préparée, illustrée et bien assaisonnée, elle le doit avant tout au goût de l’auteur pour la cuisine et pour la bouffe, la vraie, la grande à la Marco Ferreri. Car chez Cauda, comme dans le cochon tout est bon, donc tout se mange.
Artiste peintre qui n’y va pas avec le dos du pinceau, (ici de la cuiller) Jacques Cauda fait de l’huile à chaque page dans cette abominable aventure où un ex flic ripou à l’entre-jambes exacerbé passe en civet trois femmes qui tombent sous sa coulpe éminemment battue.
Oobèse nous conte les histoires croisées dans l’histoire du « Gros », dit Amalaire le dingue, (du nom d’un évêque du IXè siècle), qui met en pratique très personnelle une théorie controversée du corps du Christ en trois corps distincts, les trois parts de l’hostie. Dans la version moderne de l’affaire, « Le Gros », réincarnation new age de l’Hannibal Lecter du Silence des agneaux, préfère s’en tenir à l’enlèvement de « trois grâces », une blonde, une brune, une rousse, qu’il va occire à petit feu après moult sévices, gavages, mutilations et baises effrénées, puisqu’il faut bien évidemment passer ces dames à la casserole. Lire la suite…
Chronique cinéma : Curiosa de Lou Jeunet par Jean Azarel
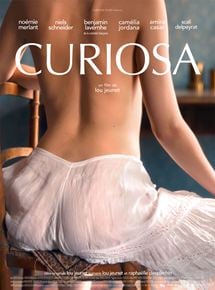
Pour son premier long métrage, la réalisatrice Lou Jeunet nous éblouit avec Curiosa. Servi par un trio d’acteurs sublimes (Noémie Merlant, qui tombe le haut comme le bas avec un naturel d’avant le péché, Nils Schneider, Benjamin Lavernhe), ce film raconte l’histoire vraie d’une des filles de l’académicien José Maria de Hérédia, Marie, avec deux écrivains aux caractères antinomiques, dans la dernière partie du 19ème siècle. Comme l’écrit Cécile Guilbert dans La Croix, cet épisode « intéresse l’histoire de la littérature, celle des mœurs ‘fin-de-siècle’ et le féminisme de notre temps ». Soulevant la chape bourgeoise des convenances, Marie de Régnier vit avec Pierre Louÿs une relation adultère passionnée. Elle s’initie avec lui à un érotisme raffiné en grades et qualité, posant nue devant son objectif tout en le partageant avec Zohra, sa seconde maîtresse algérienne. Marie gagne aussi sa propre qualité d’écrivaine à 28 ans en publiant sous le pseudonyme de Gérard d’Houville, procédé alors quasi inévitable pour une femme, le roman L’Inconstante, prélude à une carrière reconnue par le monde des lettres. Curiosa, ce n’est pas la moindre de ses vertus, nous invite à redécouvrir les œuvres croisées des trois principaux protagonistes, à une époque où la volonté (bien ébréchée de nos jours) d’une esthétique de la langue guide l’écriture. Lire la suite…