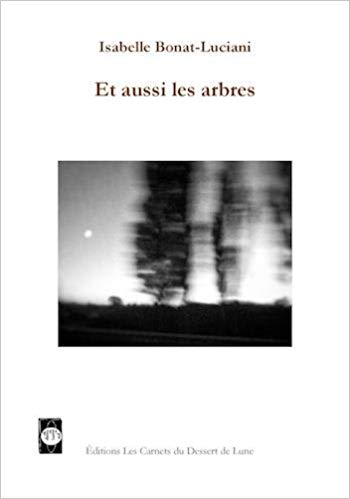Et aussi les arbres, Isabelle Bonat-Luciani, éditions les Carnets du Dessert de Lune, mai 2018
une chronique de Jean Azarel
Il y a bien des façons de chanter un baiser, à la manière d’Alain Souchon ou bien en écoutant la petite musique intime nichée dans la poésie d’Isabelle Bonat-Luciani. « Nos bouches étaient cousues / mais là où le cœur chavire. J’ai encore sa langue dans ma bouche. À chaque fois. Il était une fois. Les histoires commencent ainsi.
En prenant pour fil conducteur un morceau de pop rock qui donne son titre au livre, l’auteure dévide un écheveau crânien d’abord sagement coiffé, puis de plus en plus échevelé au fur et à mesure que les souvenirs remontent à la surface, d’abord douceâtres, puis abrupts, pour devenir aussi sales qu’une casserole laissée trop longtemps dans l’évier.
Comme dans une chanson des « Cure », les mots sont des instruments. Ils jouent à perdre haleine et entraînent le lecteur dans un pas de deux à vocation rédemptrice, sinon salvatrice.
Du seul baiser donné à Arnaud par la narratrice, surgissent de sa lampe d’Aladin, soixante pages d’une intensité rare de nos jours, toutes en pudeurs contenues où l’érotisme naît de l’impromptu, à tel point qu’un mot aussi banal que « cul » paraît cru et presque obscène quand il claque au coin d’une page.
Chez Isabelle Bonat-Luciani, le baiser tient lieu de madeleine. Elle ne le plonge pas dans une tasse de thé au risque de l’effriter et qu’il se dissolve, mais l’éparpille en petits morceaux dans un recueil écrit plume battant la chamade.
L’auteure fait aussi sienne la stratégie du Petit Poucet. Les petits cailloux qu’elle sème au fil du livre sont autant d’indices pour trouver le chemin d’une vérité enfouie dans les déconvenues et l’érosion du temps qui passe. « Nous habitions des ruines / où le chagrin transformait la mort en sommeil / pour que les sexes ressuscitent / et se taisent / et tombent / détruisent / et nous brisent / dès le premier baiser. »
Dans le maelstrom des grandes découvertes de l’adolescence, beautés fragiles et pincements au cœur se répondent, s’enlacent, s’étreignent. Mais ni l’un ni l’autre ne se muent en non lieu lorsque des années plus tard, adulte solitaire à la terrasse d’un café, la narratrice accouche le non dit d’un secret de famille, pourtant de polichinelle. « Toute ma peau y pense. Toute ma peau frémit et la page tremble / tant elle te présume / dans le geste de ma main / où naissent les rivages / et les ravages affleurent. » Car le cadavre adoré, jamais vraiment enterré, et donc jamais vraiment déterré, est un révélateur. Il a le don de transcender une vie, de lui tenir lieu de guide.
Avec Et aussi les arbres, IBL relate l’apprentissage amer des faiblesses du genre humain. Elle les raconte avec autant d’indulgence que de désenchantement. Le sensible féminin s’égratigne au rocailleux d’un cursus social formaté par l’homme dominant. Il s’y blesse, en souffre, se déconfit en sourdine, mais trouve in fine au fond de son être la force nécessaire pour exulter dans un long mantra /chanson d’amour, même si quelque chose de la grâce s’est perdu dans l’aventure. « « J’ai deux corps / l’un qui prend / l’autre qui retient / l’un qui déchire / l’autre qui recoud / et dans mes mains / un exil irrévocable. »